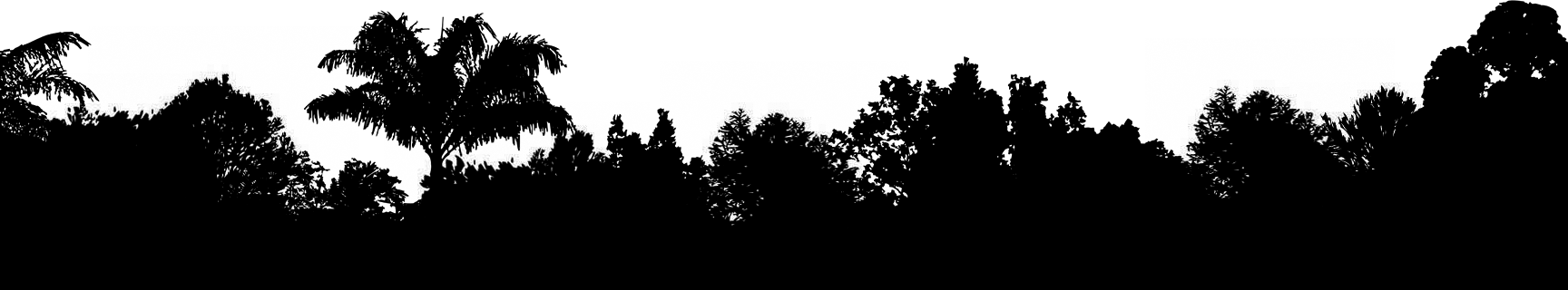Depuis quatre décennies, le professeur Sir Partha Dasgupta, économiste à Cambridge, s’efforce de faire en sorte que la valeur et l’importance de la nature soient prises en compte dans les modèles économiques de croissance, d’utilisation des ressources et de développement.
En 2019, il a été chargé par le gouvernement britannique de rédiger une étude indépendante et globale sur l’économie de la biodiversité, qui a été publiée en 2021 sous le titre de The Dasgupta Review. Considérée comme la plus grande œuvre de Dasgupta, cette étude de 600 pages appelle à modifier notre façon de penser, d’agir et de mesurer le succès économique, afin de protéger et d’améliorer le monde naturel et notre propre prospérité.
Ce travail a été largement salué par les organisations de conservation du monde entier, dont l’UICN, pour avoir défini un modèle de développement plus durable qui nous aide à comprendre les coûts de la dégradation des ressources naturelles, des écosystèmes ou de la biodiversité. Le New York Times est allé jusqu’à qualifier son rapport de « réponse à tous les problèmes ».
Unite for Nature s’est entretenu avec Sir Partha pour discuter de son travail et de l’impact de ses idées dans le monde.
Je voulais réécrire l'économie pour introduire la nature de manière transparente.